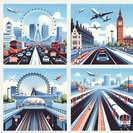La ministre de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a confirmé samedi 15 novembre 2025 que le gouvernement légiférera pour mettre fin à l’octroi automatique du statut de résident permanent (droit de séjour indéfini) à la plupart des réfugiés reconnus. Selon le projet de loi sur l’immigration à venir, les demandeurs d’asile acceptés recevraient une « protection temporaire » initiale valable 30 mois, renouvelable après une nouvelle évaluation des risques. Seules les personnes pouvant démontrer un risque individuel et persistant de persécution dans leur pays d’origine seraient éligibles à la résidence permanente après dix ans.
Les ministres expliquent que cette réforme s’inspire des mesures adoptées au Danemark en 2021 et vise à freiner le nombre record de demandes (111 000 sur l’année jusqu’en juin 2025), tout en créant un levier pour rapatrier ceux dont le pays d’origine deviendrait « sûr ». Mahmood souhaite également que les tribunaux accordent moins de poids à l’article 8 (droit à la vie familiale) et à certains aspects de l’article 3 (traitements inhumains) de la Convention européenne des droits de l’homme lors des recours contre les expulsions.
![Le Royaume-Uni remplace le statut de réfugié permanent par une protection temporaire]()
Les milieux économiques et universitaires suivent la situation de près : bien que les règles ciblent les réfugiés, les employeurs redoutent des répercussions sur la confiance du marché du travail et sur les budgets d’intégration locale. Les ONG alertent sur le fait que l’obligation pour des milliers de personnes de renouveler leur demande tous les trois ans engendrera un nouvel engorgement, augmentera les coûts de gestion pour le ministère de l’Intérieur et dissuadera les employeurs d’investir dans les programmes d’intégration des talents réfugiés.
Les avocats spécialisés en immigration soulignent que le Royaume-Uni réexamine déjà le statut humanitaire au bout de cinq ans ; réduire ce délai à 30 mois triplerait le volume des dossiers à traiter. Les bailleurs sociaux s’inquiètent également : le statut temporaire complique l’accès des réfugiés à des baux longue durée ou à des prêts hypothécaires, rendant plus complexes les dispositifs de relocalisation pour les employés internationaux ayant des membres de leur famille réfugiés.
Si cette politique est adoptée, elle marquerait le recul le plus important du modèle britannique d’asile d’après-guerre depuis l’intégration de la Convention de Genève de 1951 dans le droit national.
Les ministres expliquent que cette réforme s’inspire des mesures adoptées au Danemark en 2021 et vise à freiner le nombre record de demandes (111 000 sur l’année jusqu’en juin 2025), tout en créant un levier pour rapatrier ceux dont le pays d’origine deviendrait « sûr ». Mahmood souhaite également que les tribunaux accordent moins de poids à l’article 8 (droit à la vie familiale) et à certains aspects de l’article 3 (traitements inhumains) de la Convention européenne des droits de l’homme lors des recours contre les expulsions.

Les milieux économiques et universitaires suivent la situation de près : bien que les règles ciblent les réfugiés, les employeurs redoutent des répercussions sur la confiance du marché du travail et sur les budgets d’intégration locale. Les ONG alertent sur le fait que l’obligation pour des milliers de personnes de renouveler leur demande tous les trois ans engendrera un nouvel engorgement, augmentera les coûts de gestion pour le ministère de l’Intérieur et dissuadera les employeurs d’investir dans les programmes d’intégration des talents réfugiés.
Les avocats spécialisés en immigration soulignent que le Royaume-Uni réexamine déjà le statut humanitaire au bout de cinq ans ; réduire ce délai à 30 mois triplerait le volume des dossiers à traiter. Les bailleurs sociaux s’inquiètent également : le statut temporaire complique l’accès des réfugiés à des baux longue durée ou à des prêts hypothécaires, rendant plus complexes les dispositifs de relocalisation pour les employés internationaux ayant des membres de leur famille réfugiés.
Si cette politique est adoptée, elle marquerait le recul le plus important du modèle britannique d’asile d’après-guerre depuis l’intégration de la Convention de Genève de 1951 dans le droit national.